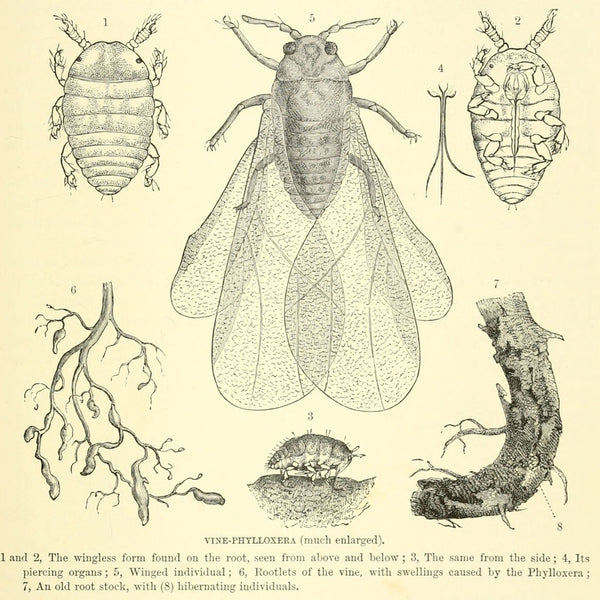Voyager à travers les cuisines du monde, c’est embarquer pour une aventure sensorielle remplie d’épices et de traditions. Pour sublimer ces mets exotiques, le choix du vin devient un art : il s’agit de trouver l’accord parfait qui révélera la richesse des saveurs sans les dominer. Explorons ensemble les plus beaux accords venus des quatre coins du globe, pour une expérience gustative inoubliable.
Asie : fraîcheur et équilibre
La gastronomie asiatique se distingue par ses jeux subtils entre douceur, acidité et épices. Pour accompagner des sushis ou sashimis japonais, privilégiez un Riesling sec d’Allemagne, dont la vivacité et les notes d’agrumes soulignent la délicatesse du poisson cru. Un Sauvignon Blanc de Nouvelle-Zélande, vif et minéral, offre également une belle harmonie.
Face à la puissance aromatique d’un curry thaïlandais, un Gewurztraminer d’Europe centrale, avec ses arômes floraux et sa légère sucrosité, adoucit le feu des épices tout en respectant la complexité. Pour les plats sautés à la sauce soja (wok, nouilles), optez pour une Syrah légère d’Australie, dont la souplesse et les notes épicées s’accordent à l’umami de la sauce.

Inde : épices et rondeur
Les plats indiens, riches en épices et en sauces généreuses, appellent des vins blancs aromatiques et légèrement sucrés. Un Viognier du Chili ou d’Afrique du Sud, aux parfums de fruits jaunes et de fleurs blanches, se marie à merveille avec un curry doux. Pour les tandoori, la légèreté d’un Pinot Noir de Nouvelle-Zélande équilibre les notes fumées et épicées de la viande. Pour les plats végétariens comme le dahl, un Chardonnay non boisé d’Australie ou de Californie apporte fraîcheur et harmonie, sans masquer la subtilité des lentilles et des épices.

Méditerranée et Moyen-Orient : soleil et générosité
Les saveurs méditerranéennes, entre herbes, épices et légumes du soleil, s’accordent avec des vins à la fois frais et aromatiques. Une paëlla espagnole s’accompagne idéalement d’un Albariño de Galice, dont la minéralité et la vivacité révèlent les notes iodées des fruits de mer, ou d’un Rioja Crianza aux arômes de fruits rouges et d’épices douces pour une version plus charnue.
Pour un tajine d’agneau aux fruits secs, misez sur un Grenache d’Espagne ou une Syrah du Maroc, généreux et épicés, qui subliment la douceur des pruneaux et la richesse de la viande. Les mezzés libanais – houmous, taboulé, kebbé – s’accordent à la fraîcheur d’un Assyrtiko grec, minéral et vif, ou à la rondeur d’un Viognier libanais.

Afrique et îles : exotisme et gourmandise
Les plats créoles, souvent relevés et conviviaux, trouvent leur équilibre avec un vin rouge issu de Syrah ou de Grenache provenant d’Australie, du Chili ou d’Afrique du Sud. Ces flacons, dotés d’une belle structure et d’arômes de fruits noirs mûrs, résistent parfaitement aux épices. Pour un poulet au lait de coco, privilégiez un Pinot Blanc d’Allemagne ou un Chenin Blanc sud-africain. Leur fraîcheur et leur douceur naturelle tempèrent la richesse du plat, tout en mettant en valeur les notes exotiques et la texture onctueuse de la sauce.
Le couscous royal, avec sa diversité de viandes et de légumes, s’associe idéalement à un rosé fruité du Chili, d’Argentine ou d’Afrique du Sud, ou encore à un Pinot Noir Rosé de Nouvelle-Zélande. Ces vins, vifs et explosifs, rafraîchissent le palais et mettent en valeur les épices sans jamais les dominer.

Amérique latine : puissance et vivacité
Les grillades argentines (asados) appellent des vins rouges puissants et fruités. Un Malbec argentin ou un Carmenère chilien, avec leurs tanins souples et leur intensité, aiment la compagnie de la viande grillée. Pour un ceviche péruvien, la fraîcheur d’un Sauvignon Blanc chilien ou d’un Albariño espagnol fait ressortir le côté acidulé et iodé du plat. Les tacos mexicains, souvent relevés, s’accordent à la douceur d’un Gewurztraminer ou d’un Viognier, qui apaisent le piquant.

Chaque association révèle une facette nouvelle des saveurs d’ailleurs. Laissez-vous guider par la curiosité et l’envie d’explorer, et chaque repas deviendra une escale gourmande sur la carte des vins du monde.