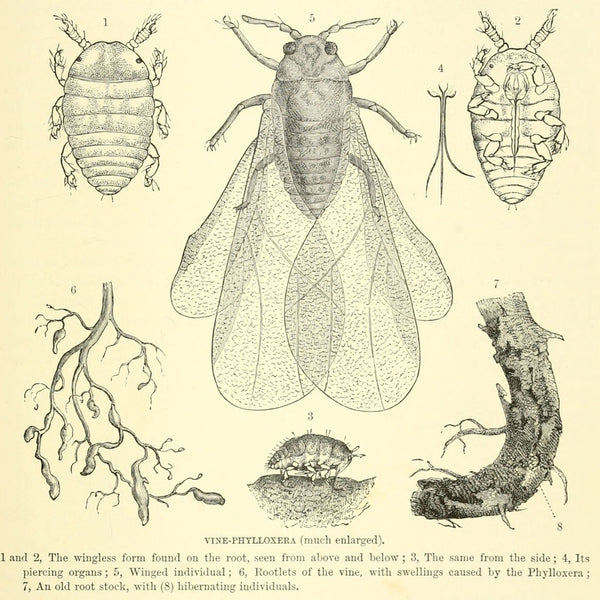Que l’on parle d’élevage, de vieillissement ou de maturation sur lies, cette technique utilisée lors de la vinification possède de nombreux avantages quant au style de vin final. De la composition de ces lies à leur rôle à la dégustation, décryptage de ce processus singulier.
Les lies, qu’est-ce que c’est ?
Pour comprendre ce que sont les lies, il faut avant tout être familier avec le processus de fermentation. Le vigneron emploie des levures, soit déjà présentes sur les raisins, soit ajoutées par leurs soins. Elles transforment les sucres en alcool puis meurent et se déposent au fond de la cuve par l’action de la gravité. Elles se mêlent aux autres résidus tels que les pépins ou quelques fragments de peau et de pulpe, formant ainsi les lies. Il peut alors choisir d’effectuer un soutirage et de les extraire, ou de les laisser pour influencer la maturation du vin, ce que l’on appelle l’élevage sur lies.
Rondeur et complexité aromatique
Ces lies ont un impact direct sur le profil du vin. Car durant l’élevage intervient leur autolyse et elles diffusent différents composés. Afin d’en tirer le maximum de propriétés, elles sont brassées régulièrement, c’est le bâtonnage. On remet les lies en suspension dans le liquide grâce à un bâton. Cela sert à libérer ces composés, dont certaines mannoprotéines qui apportent plus de rondeur, de densité et de structure. Elles réduisent également l’amertume des tanins et amplifient la palette aromatique. Dans l’ensemble, les flacons ont plus de complexité. Au fil des siècles, les producteurs ont appris à gérer parfaitement cette méthode, faisant varier le temps de vieillissement en fonction des qualités organoleptiques qu’ils souhaitent obtenir, ou préférant la mettre en place dans des cuves ou des fûts de chêne. De plus, les lies sont réductrices. Cela signifie qu’elles ralentissent l’oxydation et sont donc synonymes d’un meilleur potentiel de garde. Le vin est généralement filtré avant la mise en bouteille pour éviter les dépôts.

Notre sélection de vins élevés sur lies
Vous souhaitez proposer des vins vieillis sur lies venant des quatre coins du monde ? Faites confiance à la gamme Vinho Sélection et ses cuvées de haute facture.
Bordeaux – Fontebride Blanc 2022
Cet assemblage de 60% de Sémillon, 30% de Sauvignon Blanc et 10% de Muscadelle reste sur lies 6 à 7 mois pour préserver son fruité et sa fraîcheur. Résultat, une superbe complexité aromatique jouant sur des notes d’agrumes très matures. L’attaque, onctueuse et souple, est dominée par les fruits exotiques mûrs comme la mangue et l’ananas. Et les sols calcaires sur lesquels s’épanouissent les vignes garantissent une magnifique vivacité en fin de bouche.
Allemagne – Geil Riesling Rosengarten Trocken 2021
Place à un Riesling issu de vieilles vignes sur le cru de Rosengarten. Des sols d’argiles et de loess, une incroyable exposition sud, et une vinification minutieuse pour lui rendre hommage avec un élevage sur lies de 9 mois en cuves inox. Au nez, on perçoit des parfums de mirabelle et de pêche blanche, avec de légères nuances de fruits exotiques. Des sensations que l’on retrouve au palais, accompagnées d’une belle richesse, d’une puissance affirmée et d’une grande minéralité. Profond et droit.
Espagne – Hermanos del Villar Oro de Castilla 2022
Les levures jouent ici un rôle crucial et se dédient complètement à l’expression de la typicité aromatique du cépage espagnol Verdejo. La maturation sur lies a lieu en cuves pendant 4 mois. Derrière sa robe pâle aux reflets verdâtres se cachent des senteurs de fruits à noyau, d’agrumes et d’herbe fraîche. On est autant séduits par son volume en bouche que sa fraîcheur naturelle, sa persistance et sa finale délicatement amère.